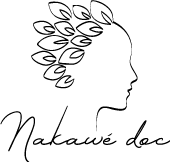Mon enfance
Je suis née le 5 décembre 1805 à Paris mais les fiches de mon état civil ont disparu dans les incendies de la semaine sanglante (mai 1871). Comme je n'ai jamais parlé de mes parents, on ne sait rien sur eux, mais j'appartenais à la classe des pauvres. « Pauvre moi-même, j'ai vu de près les souffrances des déshérités » écrirai-je plus tard à Hubertine Auclert.
Saint-simonienne et institutrice
La révolution de juillet 1830 n'a rien changé aux conditions d'existence de la grande majorité du peuple, les conditions de travail ne se sont pas améliorées et le chômage ne cesse de s'étendre. Il faut toujours être riche pour être électeur et de sexe masculin. La lecture du journal Le Globe de Pierre Leroux, saint-simonien, me donne l'envie d'un engagement politique. Cette doctrine saint-simonienne qui s'oppose à tout privilège et droit de naissance et qui estime que le peuple doit être associé à la politique, comme il l'est à la production, m'attire. Mais j'y adhère surtout pour la place qu'elle fait aux femmes, aussi bien dans ses théories que dans son organisation, car l'esclavage de la femme a toujours été ce qui m'inspira le plus d'indignation.
J'écris donc une profession de foi d'une quarantaine de pages où j'expose mes idées, entre autres : « L'esclavage de la femme est un privilège fondé sur le droit du plus fort... La femme est l'égale de l'homme, son affranchissement ne sera pas une concession, mais la reconnaissance d'un droit légitime, c'est un acte dont l'accomplissement contribuera puissamment au bonheur de l'humanité ».
C'est une période durant laquelle je lis beaucoup.
Je me marie avec le saint-simonien Antoine Ulysse Desroches, et fidèle à mes principes je refuse de porter son nom.
Je me retire de la vie politique, sans toutefois m'en désintéresser.
J'obtiens, grâce à l'aide de l'abbé Deguerry, le brevet d'institutrice ce qui me permet d'ouvrir une école pour les enfants pauvres où je place mes trois enfants, école que je dirige pendant quinze ans jusqu'en 1848.
La Voix des Femmes et l'Opinion des Femmes
Lorsque la révolution de 1848 éclate, je quitte mon école, je laisse mes enfants au soin de mon mari, et je me lance dans la révolution. Je fréquente les clubs, les réunions et je collabore à La Voix des Femmes, journal créé par Eugénie Niboyet en mars 1848, où j'y développe mes idées sur l'instruction, la réforme sociale, l'abolition des privilèges, l'égalité des sexes.
Pour l'élection de l'Assemblée constituante du mois d'avril 1848, La Voix des Femmes sollicite Pauline Roland et Georges Sand à présenter leurs candidatures, mais toutes deux refusent. Les résultats sont décevants, les socialistes n'ayant été qu'une centaine à être élus (sur 900 députés), et la situation économique et sociale reste désastreuse.
La Voix des Femmes cessant de paraître en juin 1848 après la parution de 46 numéros, je collabore au nouveau journal La Politique des Femmes de Désirée Gay.
L'été 1848, l'Assemblée interdit aux femmes l'accès aux clubs à la demande du pasteur Athanase Coquerel, et l'on peut lire dans le deuxième et dernier numéro de La Politique des Femmes : « Monsieur Coquerel, qu'avez-vous fait, nous voilà retombées dans les ténèbres de l'isolement... C'est dans ces assemblées où un grand nombre de personnes des deux sexes se réunissent dans un but éminemment social, que doit s'accomplir une œuvre immense : l'éducation morale de l'homme et l'éducation politique de la femme ».
L'année 1849, je fonde L'Opinion des Femmes pour poursuivre l'exposé de mes revendications sociales et féministes, je participe à la fondation de l'Association des instituteurs et institutrices, et je décide de me porter candidate aux élections législatives. Malgré quelques soutiens, je me heurte à l'antiféminisme de Proudhon « L'homme est apprenti, producteur et magistrat, la femme est élève, ménagère et mère de famille ». (Journal Le Peuple, 12 avril 1849) et de la majorité des démocrates-socialistes qui refusent l'inscription de mon nom sur la liste des candidats.
Malgré les moqueries, les caricatures, je reste déterminée et je mène campagne. Partout où je peux, j'interviens, je fais entendre ma voix « Le moment est venu pour la femme de prendre part au mouvement social, à l’œuvre de régénération qui se prépare »(L'Opinion des Femmes, 10 avril 1849).
L'affaire des associations
Des travailleurs de différents corps s'unirent en associations pour échapper à l'exploitation du patronat. La fondation de ces associations était une tentative d'émancipation sociale.
En août 1849, L'Opinion des Femmes avait publié un projet d'Union des associations qui comportait 52 articles dont la teneur pouvait se résumer ainsi « Le peuple doit songer à faire ses affaires lui-même, afin de réaliser la République, le gouvernement de tous par tous et pour tous ; il est temps que les travailleurs s'unissent pour vaincre l'ennemi commun qui est à la fois l'égoïsme et le capital ».
Le journal est assigné à payer une forte amende pour cette publication, et ne pouvant le faire, sa parution est contrainte de s'arrêter.
Malgré tout, le projet se poursuit. Le 5 octobre 1849, l'Union des associations fraternelles, dont j'ai rédigé les statuts, rassemble 104 associations ouvrières. Le 22 novembre, l'Union des Associations de Travailleurs établit son siège rue Saint-André-des-Arts et est déclarée conformément à la loi.
Mais le 29 mai 1850, alors que nous sommes une cinquantaine de personnes réunies, la police fait irruption et nous sommes toutes arrêtées.
Nous serons 27 à comparaître le 14 novembre devant les assises de la Seine pour délit de conspiration et de tentative de renversement du gouvernement par la force.
Je suis condamnée à six mois de prison.
Je suis libérée le 3 juillet 1851, j'aurai en fait passé treize mois derrière les barreaux.
Mon exil en Angleterre
A la suite du coup d’État du 2 décembre 1851, je porte secours aux victimes de Louis Napoléon, j'aide des persécutés à s'enfuir et je suis moi-même en danger.
En 1852, je fais paraître mon Almanach des Femmes où je continue mon combat féministe « Un almanach ne doit pas seulement indiquer les variations de température et le cours des astres, mais aussi les variations et les tendances diverses des esprits et le progrès des vérités sociales qui renferment la prophétie d'un avenir meilleur ».
Dans ce premier numéro sont publiés des articles pour dénoncer la peine de mort, j'ai toujours été contre la violence, des articles sur le travail des femmes, et même une étude sur la réforme nécessaire du costume féminin.
En août 1852 devant des menaces de plus en plus précises, je me réfugie en Angleterre, pays que je ne quitterai plus.
J'y publie un deuxième Almanach, puis un troisième en 1854, qui sera ma dernière manifestation publique.
Mes enfants m'ont rejointe et pour subvenir à nos besoins je donne des cours de français et réalise des travaux de broderie.
En 1861, j'ouvre une école pour les enfants des étrangers et des proscrits.
En 1880, d'anciens proscrits réussissent à m'obtenir une pension de 600 francs.
En 1886, j'écris une lettre à Hubertine Auclert, jeune féministe déléguée au Congrès ouvrier de Marseille de 1879, témoignant de mon intérêt toujours présent pour les causes auxquelles j'ai consacré ma vie : « Je désire y travailler encore un peu avant d'y apporter, dans ma vie suivante, avec toute l'ardeur de mes convictions religieuses et sociales, plus d'expérience et de pouvoir intellectuel ».
En 1887, je perds mon fils, et en 1893, ma fille cadette.
Je vis le reste de mes jours avec ma fille aînée qui m'a toujours soutenue.
Je meurs en 1894.